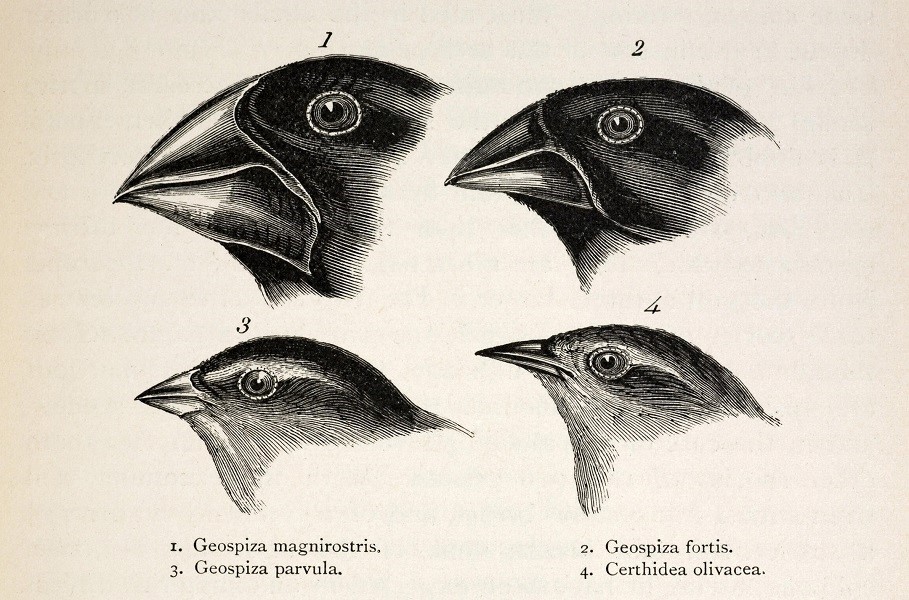
Le concept de biodiversité est devenu central dans les débats autour de l’environnement et de sa préservation, démontrant l’importance de l’évaluation de son état.
Malgré son importance capitale dans l’étude des écosystèmes et des êtres vivants, et bien qu’il s’agisse d’une discipline ancestrale, ce terme n’a même pas 50 ans. En effet, il résulte de plusieurs siècles de découvertes scientifiques dont nous allons faire un court aperçu.
Dans cet article, nous allons remonter à l’origine de l’étude des êtres vivants et de leur habitat jusqu’à l’apparition du terme “biodiversité”. Pour cela, nous présenterons plusieurs des grands scientifiques qui ont contribué à faire de cette discipline ce qu’elle est aujourd’hui :
- Linné et la classification des êtres vivants
- Lamarck et le concept d’évolution dans le transformisme
- Darwin et la théorie de l’évolution
- La 1ère convention sur le climat
Linné et la classification des êtres vivants
Nous sommes au 18ᵉ siècle à Uppsala, en Suède, lorsqu’un naturaliste nommé Carl von Linné entreprend pour la première fois de proposer une classification systématique des êtres vivants. Son objectif est de discriminer et de regrouper les espèces selon des critères morphologiques, c’est-à-dire basés sur leur apparence et leurs caractéristiques physiques. En 1735, il publie son ouvrage majeur, Systema Naturae, qui pose les bases de la classification moderne.
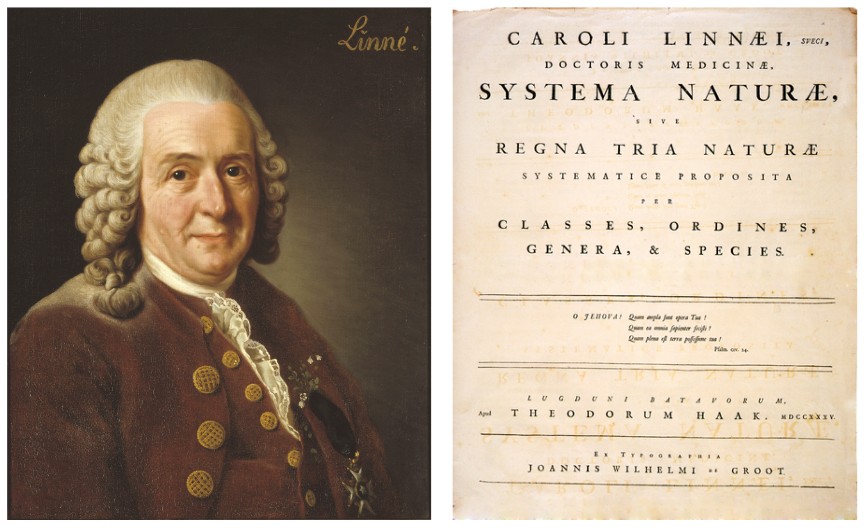
Mais l’ambition de Linné dépasse la simple curiosité scientifique. À cette époque, la théorie dominante est celle du fixisme : toutes les espèces auraient été créées par Dieu, parfaitement adaptées, et aucune n’aurait disparu ni évolué depuis leur origine. Comme l’affirme Linné lui-même : « Nous comptons autant d’espèces qu’il y a eu au commencement de formes diverses créées ». Ainsi, en classant et organisant les espèces selon une logique ordonnée, Linné espère percer les intentions du créateur.
On lui doit encore aujourd’hui le système binomial de nomenclature, qui attribue à chaque être vivant un nom composé de deux parties : le nom de genre (en italique et avec une majuscule) et le nom d’espèce (en italique et avec une minuscule). Par exemple, Homo sapiens pour l’être humain, Bos taurus pour la vache, etc.
Linné introduit ainsi un cadre pour décrire la diversité des formes du vivant et pose les premières bases de ce qu’on appellera bien plus tard la biodiversité. Pourtant, au 18ᵉ siècle, certains commencent déjà à remarquer que le vivant fluctue : des fossiles témoignent de formes disparues, et des espèces menacées attirent l’attention des naturalistes, remettant en question l’idée que la nature est immuable.
Lamarck et le concept d’évolution dans le transformisme
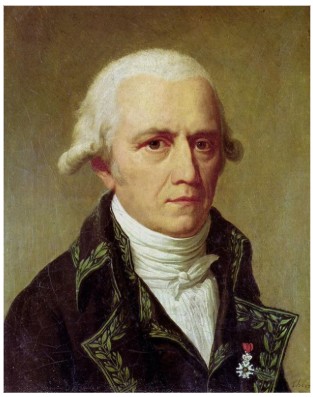
Il faudra attendre plus d’un demi-siècle après Linné pour qu’un naturaliste remette en cause le fixisme. Le français Jean-Baptiste de Lamarck, professeur au Jardin du Roi puis au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, propose au début du 19ᵉ siècle une théorie révolutionnaire pour son époque : le transformisme.
Selon lui, les espèces ne sont pas fixes, mais se transforment dans le temps sous l’effet de leur environnement. Sa théorie repose sur deux principes majeurs :
-
L’adaptation des organes aux besoins : les êtres vivants seraient capables de modifier leurs organes en fonction de l’usage qu’ils en font. Par exemple, une girafe, pour atteindre les feuilles des arbres en hauteur, étirerait son cou au fil de sa vie.
-
L’hérédité des caractères acquis : ces transformations seraient transmises à la descendance. Ainsi, le cou allongé d’une girafe serait hérité par ses petits, qui l’allongeraient davantage, et ainsi de suite.
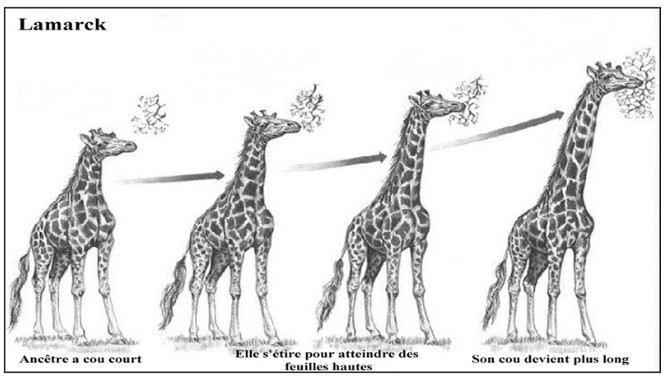
Bien que cette théorie soit aujourd’hui dépassée, elle introduit deux idées fondamentales :
- Le vivant évolue dans le temps, certaines espèces disparaissent, d’autres apparaissent ou se modifient.
- L’environnement joue un rôle direct dans la formation de cette diversité, en exerçant des pressions qui façonnent les espèces.
Lamarck pose ainsi les premiers jalons du lien entre diversité des milieux et diversité biologique, une notion centrale dans la définition moderne de la biodiversité, même si son mécanisme de transmission héréditaire était erroné.
Darwin et la théorie de l’évolution
Quelques décennies après Lamarck, un autre naturaliste britannique bouleverse définitivement notre vision du vivant : Charles Darwin. En 1859, après un voyage de 5 ans à bord du HMS Beagle il publie De l’origine des espèces, où il expose la théorie de l’évolution par sélection naturelle.
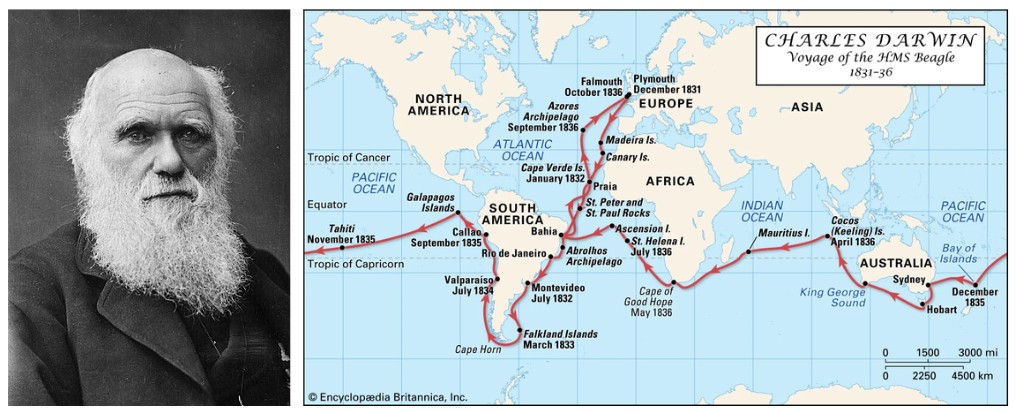
Darwin part d’un constat simple : au sein d’une même espèce, il existe des variations. Ces variations, parfois héréditaires, peuvent avantager certains individus dans leur environnement. Ces derniers auront plus de chances de survivre et de se reproduire, transmettant ainsi leurs caractéristiques avantageuses à leur descendance. Mais contrairement à la théorie de Lamarck :
- Ce ne sont pas les besoins des individus qui modifient leur anatomie, mais des variations aléatoires.
- Seules les variations avantageuses sont sélectionnées naturellement car elles favorisent la survie et la reproduction.
Cette théorie permet pour la première fois de comprendre l’origine de la diversité biologique : elle est le résultat de l’accumulation de variations héréditaires sélectionnées par l’environnement au fil du temps.
Un exemple classique illustrant la sélection naturelle est celui de la phalène du bouleau (Biston betularia) en Angleterre.
Avant la révolution industrielle, la forme claire de ce papillon était majoritaire car elle se camouflait mieux sur les troncs des bouleaux recouverts de lichens. Avec la pollution et le noircissement des arbres, les formes sombres, auparavant rares et plus visibles, sont devenues avantagées car elles échappaient mieux aux prédateurs. En quelques décennies, leur fréquence a fortement augmenté. Ce phénomène, appelé mélanisme industriel, illustre parfaitement le mécanisme de sélection naturelle décrit par Darwin : des variations préexistantes dans une population peuvent être favorisées ou éliminées selon les modifications de l’environnement.
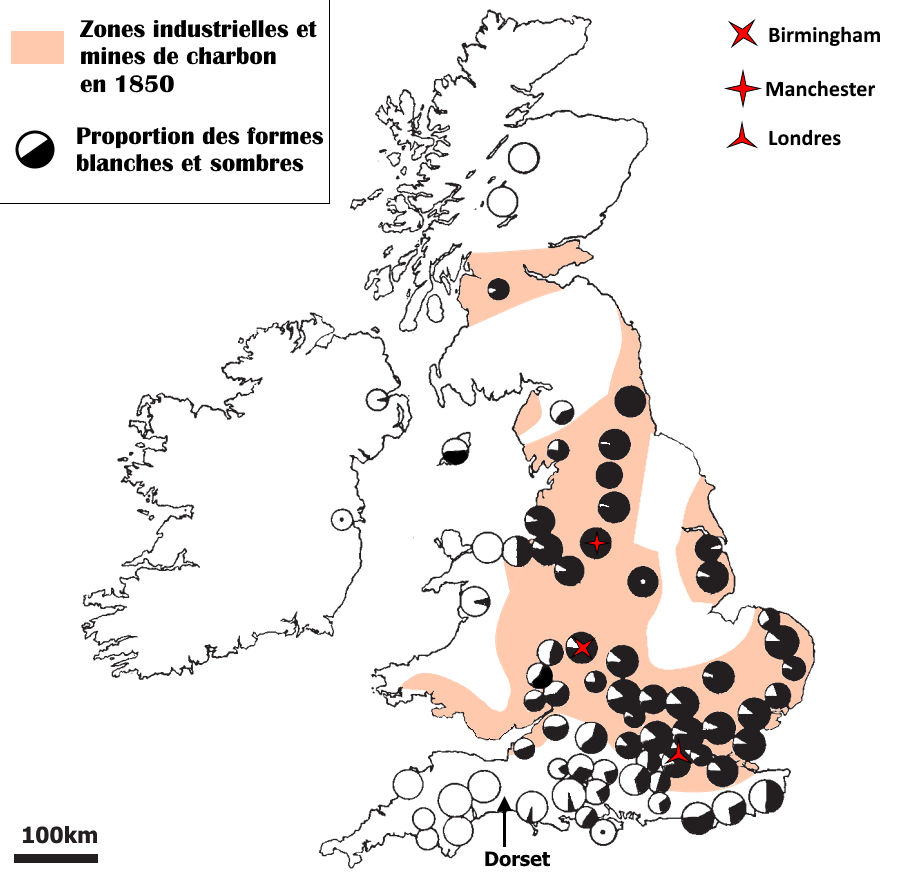
C’est un tournant décisif pour la définition de la biodiversité. On comprend désormais qu’elle est le produit d’un processus évolutif continu où les espèces apparaissent, disparaissent et se diversifient en fonction des changements du milieu et des pressions de sélection. La biodiversité n’est donc pas figée, mais un patrimoine dynamique, en perpétuelle transformation.
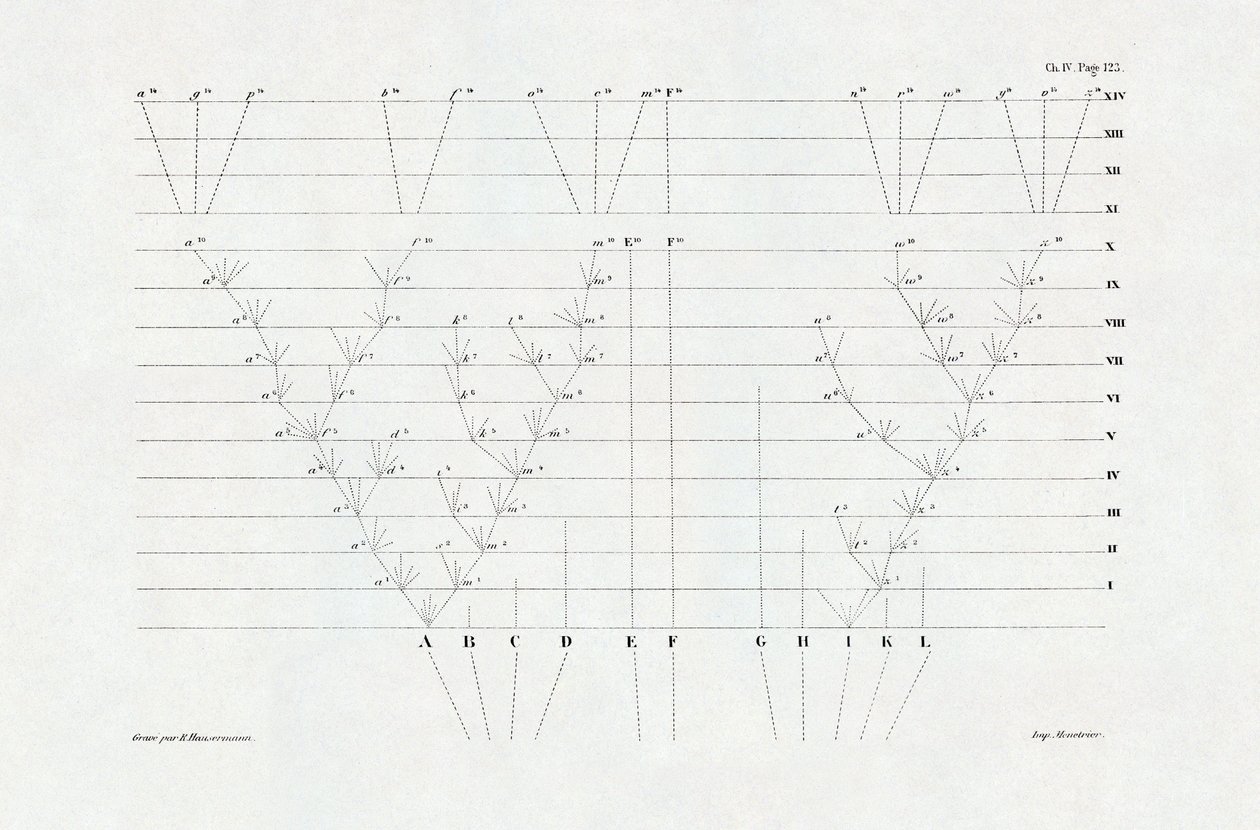
Il s’agit de l’unique schéma de l’ouvrage majeur de Charles Darwin, De l’origine des espèces (1859). Il s’agit du premier arbre phylogénétique dessiné de l’histoire, dans lequel Darwin propose une représentation graphique de la divergence évolutive des espèces au cours du temps. Chaque ligne horizontale représente un intervalle de temps, et les lignes ramifiées illustrent la diversification progressive des espèces à partir d’un ancêtre commun. Ce schéma incarne parfaitement le concept moderne de biodiversité, non comme une simple liste d’espèces actuelles, mais comme le résultat d’une histoire évolutive dynamique et continue.
La biodiversité se définit aujourd’hui comme la variabilité des organismes vivants de toute origine, incluant la diversité au sein des espèces, entre les espèces et celle des écosystèmes. Ici, Darwin montre que cette diversité est le produit de divergences successives, d’adaptations à des milieux variés et de l’extinction de certaines lignées (celles qui s’arrêtent avant d’atteindre le haut du schéma). Ainsi, la biodiversité actuelle est un instantané d’un processus physique évolutif ininterrompu, et ce schéma en est une très bonne illustration.
La première convention internationale sur le climat et l’environnement
Alors que la biodiversité a longtemps été étudiée sous l’angle scientifique, il faudra attendre la fin du 20ᵉ siècle pour que sa préservation devienne un enjeu international. En 1992, à Rio de Janeiro, l’ONU organise le premier Sommet de la Terre, qui réunit chefs d’État, scientifiques et ONG pour aborder ensemble les grands défis environnementaux.

De cette conférence naîtront plusieurs textes majeurs, dont la Convention sur la diversité biologique (CDB). C’est la première fois que la biodiversité est reconnue comme un bien commun de l’humanité, indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes et à la survie des sociétés humaines.
Mais qu’est-ce que la biodiversité ? Le terme désigne la variété et la variabilité du vivant à toutes les échelles :
- Diversité des écosystèmes : forêts, récifs coralliens, déserts, zones humides…
- Diversité des espèces : le nombre et la variété d’êtres vivants.
- Diversité génétique : les différences au sein d’une même espèce, entre individus et populations.
Voir l’article complet “Qu’est ce que la biodiversité ?”
Cette prise de conscience mondiale marque un tournant : la biodiversité devient un enjeu politique, économique et éthique, indissociable de la lutte contre le réchauffement climatique, la déforestation et l’effondrement des espèces.




